Analyses et points de vue
La trahison ontologique : de la complaisance criminelle et de l’indignité absolue
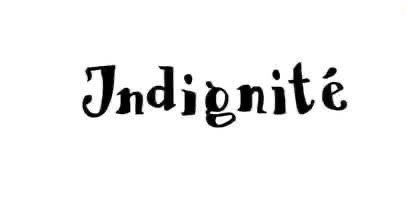
Le drame de la RD Congo n’est pas une simple tragédie ; c’est une dissection clinique de l’âme humaine confrontée à la tentation du mal. Il ne s’agit plus de géopolitique, d’économie ou de rivalités ethniques. Ces lectures sont des leurres, des rationalisations tardives pour une vérité plus noire, plus philosophiquement accablante.
Nous sommes face à un crime de lèse-humanité perpétré contre un peuple, mais orchestré, facilité et justifié par une catégorie d’individus dont l’indignité est totale : ceux qui, consciemment, ont pactisé avec le projet génocidaire rwandais. Toute analyse qui tenterait de nuancer, de contextualiser ou de compartimenter cette trahison est, en soi-même, une forme de complicité intellectuelle.
Il n’existe pas de raisons valables, seulement des alibis méprisables. L’argument de la realpolitik, de la survie, de l’opportunisme ou de la vengeance devient, dans ce cadre précis, le langage creux de la lâcheté spirituelle. Pactiser avec l’ennemi rwandais – cet État prédateur dont le projet hégémonique est lavé dans le sang génocidaire de 1994 et nourri par une idéologie ethno-nationaliste expansionniste – n’est pas une transaction.
C’est un pacte faustien d’un ordre particulier. Ici, l’âme n’est pas échangée contre la connaissance ou le pouvoir, mais contre une illusion : l’illusion d’être du bon côté de la machette. Le collaborateur congolais, qu’il soit homme politique, militaire, homme d’affaires ou intellectuel, croit utiliser le levier rwandais pour ses ambitions. En réalité, il se nie lui-même. Il devient un instrument conscient de la destruction de sa propre substance nationale.
Il devient un fossoyeur actif du monde qui l’a engendré. Cette trahison est une abdication de la responsabilité ontologique la plus fondamentale : celle d’être un rempart pour les siens. En ouvrant les portes, en légitimant l’ingérence, en fournissant des justifications, en partageant le butin, ces individus ont franchi une ligne non pas morale, mais métaphysique. Ils ont volontairement choisi de se placer en dehors du cercle de l’humanité partagée.
Ils ont préféré le rôle de l’auxiliaire dans l’entreprise de déshumanisation d’autrui. Il est iconoclaste, aujourd’hui, de refuser toute excuse. Notre époque aime les gris, les zones d’ombre, les psychologies des bourreaux. Cette tendance est une faiblesse mortelle. Face à un mal aussi systémique, aussi lucide et aussi fructueux que celui déployé contre le Congo, l’intellectualisme qui cherche à comprendre est un renoncement.
Il faut briser l’idole de la complexité derrière laquelle se cachent les traîtres. La situation n’est complexe que pour ceux qui refusent de nommer le Mal par son nom. Le projet est simple : la prédation, le dépeçage et l’asservissement d’un État et de son peuple, considérés comme un non-être, une simple ressource à exploiter. Ceux qui s’y associent, à quelque niveau que ce soit, adhèrent à cette vision.
Leur indignité n’est pas une question de degré ; elle est binaire. On est digne ou indigne. Et ils ont choisi. Le peuple congolais, dans sa résilience quasi-charnelle, porte en lui la mémoire des souffrances. Cette mémoire n’est pas passive. Elle est un tribunal bien plus implacable que toute cour de justice humaine. Elle jugera, et elle a déjà jugé. Elle identifiera, sans procès et sans appel, tous ceux dont les noms sont gravés.
Non dans le marbre des monuments, mais dans la boue des charniers et dans les larmes des veuves. L’indignité nationale de ces pactisateurs est éternelle. Elle ne sera pas effacée par les réconciliations politiques de convenance, les accords secrets ou les réussites matérielles ultérieures. Ils sont marqués du sceau de Caïn, non par Dieu, mais par l’Histoire qu’ils ont trahie, le peuple Congolais qu’ils ont honni.
Ils ont troqué leur appartenance à un peuple contre une place à la table des vainqueurs éphémères. Mais l’Histoire a un sens long, et la vérité finit toujours par ressurgir des fosses communes. En ces temps de cynisme et de compromission, la seule position intellectuellement tenable et moralement défendable est l’intransigeance absolue. Il n’y a pas de dialogue possible avec la trahison.
Il n’y a pas de rédemption pour ceux qui ont offert leur peuple en pâture. Le combat pour la dignité du Congo passe par le refus catégorique de toute réhabilitation de ces figures de l’ombre. Leur nom doit être associé à l’infamie, leur héritage à la honte. C’est seulement en maintenant cette exigence de pureté éthique, aussi radicale soit-elle, que le Congo pourra, un jour, se reconstruire sur des fondations autres que celles du sang et de la trahison.
Le pardon peut être une vertu chrétienne, mais pour la Nation, le devoir de mémoire et le verdict de l’Histoire sont des impératifs non-négociables. Leur indignité est notre rappel constant de la vigilance nécessaire pour préserver l’âme même de la nation. Mieux vaut la poussière, l’humiliation, la pauvreté et le deuil sur la tête du juste que la pourpre, la richesse, le pouvoir et ses honneurs sur les épaules du traître.
TEDDY MFITU
Polymathe, chercheur et écrivain / Consultant senior cabinet CICPAR
Analyses et points de vue
Tribune : “Ils servent à quoi ?” – Quand le service public trahit le peuple congolais ( Par Régis Mbuyi Ngudie/Philosophe, communicologue et penseur libre)

Face à la détresse du peuple congolais, une question s’impose, simple mais percutante : ils servent à quoi ? Cette interrogation, loin d’être une provocation, exprime la profonde lassitude d’un peuple qui ne comprend plus le sens du mot service public. Car comment expliquer que, dans un pays si riche en ressources naturelles, la pauvreté soit devenue une norme et la misère, un destin ?
À quoi sert le Directeur général de la SNEL, s’il n’y a pas d’électricité dans les foyers, même chez ceux qui paient régulièrement le prépayé ? Dans plusieurs quartiers de Kinshasa, la lumière est devenue un luxe. Des ménages passent des jours entiers dans le noir pendant que les autorités multiplient les promesses.
Et la Régie des Eaux, à quoi sert-elle si des pans entiers de la capitale et des provinces n’ont toujours pas accès à l’eau potable ? Comment comprendre que des familles, épuisées, doivent acheter de l’eau à des prix exorbitants tout en recevant des factures salées pour un service inexistant ?
Et la Police nationale congolaise, à quoi sert-elle si l’insécurité s’installe comme une seconde nature ? Chaque jour, des citoyens sont agressés, volés, parfois tués, pendant que les institutions censées protéger se contentent d’observer. L’insécurité a cessé d’être un phénomène ; elle est devenue un système.
Pendant ce temps, le pouvoir d’achat s’effondre. Le taux du dollar fluctue, mais jamais au profit du citoyen. Les prix des denrées alimentaires s’envolent, les salaires stagnent. Des fonctionnaires de l’État passent des mois sans salaire, mais continuent d’accomplir leur devoir avec résignation. À quoi sert donc l’administration publique, si ceux qui la font vivre sont traités avec indifférence ?
Et que dire des églises, présentes à chaque coin de rue, mais impuissantes à guérir le mal profond de la société ? L’Évangile s’est transformé en spectacle et la foi, en commerce. Où est passée la puissance de l’amour chrétien — celui qui pousse à aimer, à aider, à partager ? La spiritualité a déserté le quotidien, remplacée par une religiosité de façade qui ne change ni les cœurs ni les comportements.
Nos parlementaires, quant à eux, semblent vivre dans un autre monde. Les grands débats nationaux tournent autour des ambitions personnelles, des alliances politiques, des calculs électoraux. Pendant ce temps, les vrais problèmes — chômage, faim, santé, éducation — sont relégués au second plan. Le peuple, lui, continue de souffrir en silence, trahi par ceux qu’il a élus pour le représenter.
Mais la responsabilité ne revient pas seulement aux dirigeants. Et nous, peuple congolais ? À quoi servons-nous, si nous restons spectateurs de notre propre malheur ? Notre silence face à l’injustice est devenu une complicité. Nous crions notre douleur, mais refusons d’agir. Nous dénonçons la corruption, mais la reproduisons à petite échelle dans nos gestes quotidiens. Nous attendons un sauveur, au lieu de devenir le changement que nous espérons.
Le Congo ne se relèvera pas par miracle. Il se relèvera par la conscience, le courage et la responsabilité de ses fils et filles. Les dirigeants doivent se souvenir qu’ils sont les serviteurs du peuple, non ses maîtres. Et le peuple doit comprendre qu’un pays ne change que lorsque ses citoyens cessent d’accepter l’inacceptable.
Alors, la question demeure, brûlante et urgente : Ils servent à quoi ?
Mais surtout : nous servons à quoi, si nous continuons à nous taire ?
